
Cannes 2024 – Eryk Rocha et Gabriela Carneiro da Cunha réalisateurs de "La chute du ciel" : "Ce film est un avertissement"
Date de publication : 21/05/2024 - 10:00
Eryk Rocha a reçu en 2016 à Cannes l'Œil d'or du meilleur documentaire pour son film Cinema Novo, quant à Gabriela Carneiro da Cunha, directrice de théâtre, chercheuse et activiste artistique environnementale, elle passe pour la première fois à la réalisation avec La Chute du ciel présenté dans le cadre de la Quinzaine.
Comment décririez-vous La Chute du ciel en quelques mots ?
Il est difficile de définir un film qui est en train de naître et dont le sens viendra de sa relation avec le public. En tant que créateurs, nous considérons le film comme un avertissement et un diagnostic de ce que Davi Kopenawa appelle La Chute du ciel et, plus récemment, La revanche du monde. Mais c'est surtout une invitation pour les non-indigènes à rêver plus grand.
Tout a commencé avec le texte de Davi Kopenawa et Bruce Alber ?
Ce film est l'expression cinématographique d'une relation, du ravissement que nous avons ressenti à la lecture du livre, bien sûr, mais surtout de ce que nous avons vécu en chair, en os et en esprit au cours des sept dernières années de notre relation avec Davi, la communauté de Watorikɨ et les Yanomami. C'est un film dans lequel la caméra ne regarde pas seulement les Yanomami, mais aussi nous, les non-indigènes. Nous avons cherché à faire un film qui exprime la matérialité onirique d'une relation.
Quelles ont été les différentes étapes du développement du film ?
Nous avons travaillé sur plusieurs versions du scénario en nous basant sur le livre. Ces versions étaient principalement axées sur la troisième partie du livre, où l'accent est mis sur une sorte de contre-anthropologie dans laquelle Davi Kopenawa devient l'ethnographe de la culture de ceux qu'il appelle le peuple des marchands. Nous avons également fait beaucoup de recherches sur la culture et la langue des Yanomami. Puis tout a changé avec notre expérience de tournage avec les Yanomami pendant le festival Reahu à Watorikɨ, où vivent Davi Kopenawa et sa famille, chez les Yanomami, le plus grand territoire indigène du Brésil. Ce fut une expérience radicale et transformatrice. Ensuite, le processus de montage sur l'île, le partenariat avec le monteur Renato Vallone et la conception sonore de Guile Martins ont été très importants pour la forme finale et la matérialisation d'un langage dont nous avions commencé à rêver il y a des années. Le film est donc né de nouveau à chaque étape de sa création.
Comment avez-vous trouvé vos autres producteurs en France et en Italie ?
Tout a commencé par une coproduction entre notre société de production Aruac Filmes et l'association Hutukara Yanomami. Nous avons passé des années à préparer le film et à former une équipe hybride composée d'autochtones et de non-autochtones. Nous avons formé de jeunes réalisateurs yanomami qui ont travaillé sur le film pendant le tournage et ont également réalisé leurs propres films, récemment été présentés dans divers festivals de cinéma et d'art au Brésil et dans le monde entier.
Nous pensons que les coproductions sont la genèse de ce projet. La coproduction avec la France était tout à fait logique étant donné que le livre est le fruit du travail de l'anthropologue français Bruce Albert et du chaman Yanomami Davi Kopenawa, et qu'il a été publié en premier lieu en France. La coproduction avec l'Italie est née de notre désir de collaborer avec Donatela Palermo, une productrice que nous admirons beaucoup et qui a déjà produit des films de réalisateurs que nous admirons beaucoup, comme Gianfranco Rossi.
Où et quand avez-vous tourné exactement ?
Pendant le festival Reahu en l'honneur du beau-père de Davi Kopenawa, un chaman très important pour les Yanomami et pour Davi en particulier, car c'est lui qui a initié Davi au chamanisme.
N'était-ce pas compliqué d'amener une caméra au milieu de certains rituels ?
Ce film est né de plusieurs rencontres. La rencontre de Davi Kopenawa et de Bruce Albert. Notre rencontre avec le livre La chute du ciel. Et puis la rencontre avec les Yanomami, et leur rencontre avec nous. Nous avons filmé avec une équipe qui était mixte avec indigènes et non-indigènes, et qui était très petite. La caméra entre dans cette relation, tout comme le corps, les yeux et les oreilles. Il ne s'agit pas de garder quelque chose d'immuable et de distant, mais de changer en même temps que ce qui nous affecte. C'est dans ce sens que notre rencontre et notre relation avec Davi Kopenawa, la communauté Watoriki et le peuple Yanomami ont eu lieu, comme une confluence entre les cinémas : le cinéma avec la caméra, le microphone et le montage ; et le cinéma de la théâtralité, du Yãkoana et du rituel. Tous deux dans un effort mutuel pour se trouver, se provoquer, se tendre et se croiser ont permis créer des images et des sons qui soutiennent un ciel au bord de l'effondrement.
Qu'attendez-vous de cette sélection à la Quinzaine ?
C'est une joie d'être à Cannes, à la Quinzaine des cinéastes, dans une section reconnue pour son audace et son raffinement esthétique. C'est un film qui cherche son propre langage et cette recherche est ici complètement acceptée. D'une certaine manière, il est agréable de penser que La chute du ciel aura une vie en France, pays de l'un des auteurs du livre, Bruce Albert, et qu'il circulera bientôt aussi en terre indigène Yanomami.
En outre, ces dernières années, le monde a vu de nombreuses images des Yanomami souffrant de ce qui a été une nouvelle fois une grave crise sanitaire et humanitaire. Le film traite également de ces questions, mais il présente aussi des images des Yanomami dans leur puissance et leur beauté. Il raconte une relation indéniable entre les Yanomami et les napë - nous, les Blancs. Il ne s'agit donc pas seulement de montrer la lutte et la culture des Yanomami, mais aussi la culture de la destruction et de l'exploitation qui prévaut parmi ce que Davi appelle si justement le "peuple de la marchandise". Ce sont ces visions du monde, de l'image et du cinéma qui sont en débat, et dont nous avons à cœur qu'elles soient débattues dans un festival comme Cannes. Davi sait parfaitement nommer les personnes qui veulent voler la forêt des Yanomami et les traces que ces personnes et leur système économique ont laissées sur la terre. Le désir est donc que la culture Yanomami soit perçue comme une culture vivante, contemporaine et florissante, mais aussi que la culture Nape se perçoive dans une perspective chamanique et contre-coloniale.
Il est difficile de définir un film qui est en train de naître et dont le sens viendra de sa relation avec le public. En tant que créateurs, nous considérons le film comme un avertissement et un diagnostic de ce que Davi Kopenawa appelle La Chute du ciel et, plus récemment, La revanche du monde. Mais c'est surtout une invitation pour les non-indigènes à rêver plus grand.
Tout a commencé avec le texte de Davi Kopenawa et Bruce Alber ?
Ce film est l'expression cinématographique d'une relation, du ravissement que nous avons ressenti à la lecture du livre, bien sûr, mais surtout de ce que nous avons vécu en chair, en os et en esprit au cours des sept dernières années de notre relation avec Davi, la communauté de Watorikɨ et les Yanomami. C'est un film dans lequel la caméra ne regarde pas seulement les Yanomami, mais aussi nous, les non-indigènes. Nous avons cherché à faire un film qui exprime la matérialité onirique d'une relation.
Quelles ont été les différentes étapes du développement du film ?
Nous avons travaillé sur plusieurs versions du scénario en nous basant sur le livre. Ces versions étaient principalement axées sur la troisième partie du livre, où l'accent est mis sur une sorte de contre-anthropologie dans laquelle Davi Kopenawa devient l'ethnographe de la culture de ceux qu'il appelle le peuple des marchands. Nous avons également fait beaucoup de recherches sur la culture et la langue des Yanomami. Puis tout a changé avec notre expérience de tournage avec les Yanomami pendant le festival Reahu à Watorikɨ, où vivent Davi Kopenawa et sa famille, chez les Yanomami, le plus grand territoire indigène du Brésil. Ce fut une expérience radicale et transformatrice. Ensuite, le processus de montage sur l'île, le partenariat avec le monteur Renato Vallone et la conception sonore de Guile Martins ont été très importants pour la forme finale et la matérialisation d'un langage dont nous avions commencé à rêver il y a des années. Le film est donc né de nouveau à chaque étape de sa création.
Comment avez-vous trouvé vos autres producteurs en France et en Italie ?
Tout a commencé par une coproduction entre notre société de production Aruac Filmes et l'association Hutukara Yanomami. Nous avons passé des années à préparer le film et à former une équipe hybride composée d'autochtones et de non-autochtones. Nous avons formé de jeunes réalisateurs yanomami qui ont travaillé sur le film pendant le tournage et ont également réalisé leurs propres films, récemment été présentés dans divers festivals de cinéma et d'art au Brésil et dans le monde entier.
Nous pensons que les coproductions sont la genèse de ce projet. La coproduction avec la France était tout à fait logique étant donné que le livre est le fruit du travail de l'anthropologue français Bruce Albert et du chaman Yanomami Davi Kopenawa, et qu'il a été publié en premier lieu en France. La coproduction avec l'Italie est née de notre désir de collaborer avec Donatela Palermo, une productrice que nous admirons beaucoup et qui a déjà produit des films de réalisateurs que nous admirons beaucoup, comme Gianfranco Rossi.
Où et quand avez-vous tourné exactement ?
Pendant le festival Reahu en l'honneur du beau-père de Davi Kopenawa, un chaman très important pour les Yanomami et pour Davi en particulier, car c'est lui qui a initié Davi au chamanisme.
N'était-ce pas compliqué d'amener une caméra au milieu de certains rituels ?
Ce film est né de plusieurs rencontres. La rencontre de Davi Kopenawa et de Bruce Albert. Notre rencontre avec le livre La chute du ciel. Et puis la rencontre avec les Yanomami, et leur rencontre avec nous. Nous avons filmé avec une équipe qui était mixte avec indigènes et non-indigènes, et qui était très petite. La caméra entre dans cette relation, tout comme le corps, les yeux et les oreilles. Il ne s'agit pas de garder quelque chose d'immuable et de distant, mais de changer en même temps que ce qui nous affecte. C'est dans ce sens que notre rencontre et notre relation avec Davi Kopenawa, la communauté Watoriki et le peuple Yanomami ont eu lieu, comme une confluence entre les cinémas : le cinéma avec la caméra, le microphone et le montage ; et le cinéma de la théâtralité, du Yãkoana et du rituel. Tous deux dans un effort mutuel pour se trouver, se provoquer, se tendre et se croiser ont permis créer des images et des sons qui soutiennent un ciel au bord de l'effondrement.
Qu'attendez-vous de cette sélection à la Quinzaine ?
C'est une joie d'être à Cannes, à la Quinzaine des cinéastes, dans une section reconnue pour son audace et son raffinement esthétique. C'est un film qui cherche son propre langage et cette recherche est ici complètement acceptée. D'une certaine manière, il est agréable de penser que La chute du ciel aura une vie en France, pays de l'un des auteurs du livre, Bruce Albert, et qu'il circulera bientôt aussi en terre indigène Yanomami.
En outre, ces dernières années, le monde a vu de nombreuses images des Yanomami souffrant de ce qui a été une nouvelle fois une grave crise sanitaire et humanitaire. Le film traite également de ces questions, mais il présente aussi des images des Yanomami dans leur puissance et leur beauté. Il raconte une relation indéniable entre les Yanomami et les napë - nous, les Blancs. Il ne s'agit donc pas seulement de montrer la lutte et la culture des Yanomami, mais aussi la culture de la destruction et de l'exploitation qui prévaut parmi ce que Davi appelle si justement le "peuple de la marchandise". Ce sont ces visions du monde, de l'image et du cinéma qui sont en débat, et dont nous avons à cœur qu'elles soient débattues dans un festival comme Cannes. Davi sait parfaitement nommer les personnes qui veulent voler la forêt des Yanomami et les traces que ces personnes et leur système économique ont laissées sur la terre. Le désir est donc que la culture Yanomami soit perçue comme une culture vivante, contemporaine et florissante, mais aussi que la culture Nape se perçoive dans une perspective chamanique et contre-coloniale.
Recueilli par Patrice Carré
© crédit photo : DR
L’accès à cet article est réservé aux abonnés.
Vous avez déjà un compte
Accès 24 heures
Pour lire cet article et accéder à tous les contenus du site durant 24 heures
cliquez ici






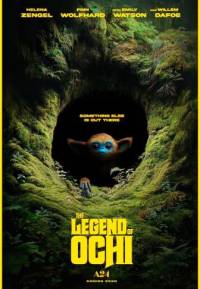 La légende
La légende